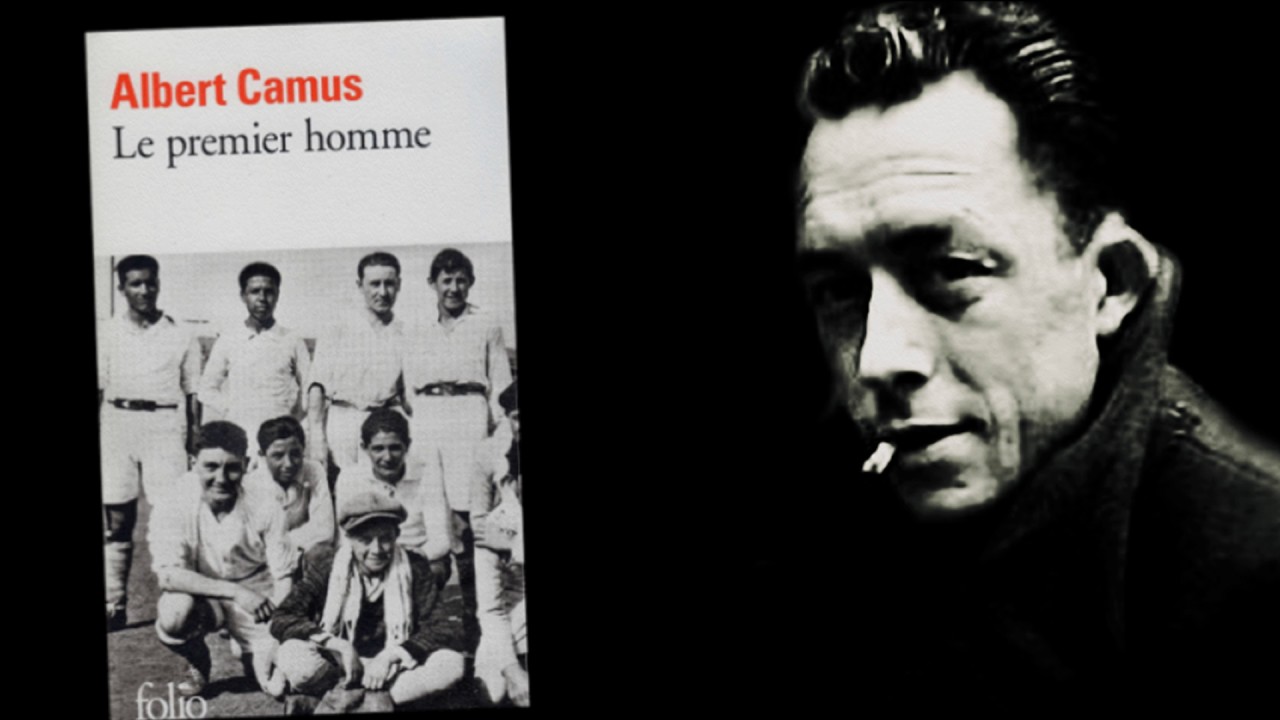« Un hectare de bonne terre au Frais-Vallon, ça suffit ! nous dit Salvator Nin ; moins ce ne serait pas assez ; plus, ce serait trop. Un hectare. Un point c’est tout. Le fils est au service, la fille est établie. La mère et moi on est deux ; à la maison elle commande ; au potager c’est moi, sauf quand je donne un coup de rein pour blanchir la maison ; aussi c’est moi qui saigne le cochon et qui le découpe et c’est la mère qui fait la soubressade. Je suis le roi du jardin ; quand le travail presse, j’embauche des manœuvres kabyles. Pour l’arrosage, vous en faites pas ; dans le haut de mon terrain, j’ai une fameuse noria, un mulet pour la tourner, une pente douce où l’irrigation se fait toute seule. Aux environs il n’est personne qui conduise aussi bien l’eau que moi. Et les collègues tous ils viennent me demander conseil pour le bassin et les rigoles. Je suis de compte à demi avec un copain qui a un camion ; on partage les frais d’essence et d’huile et je lui donne en plus une bagatelle pour l’amortissement ; c’est lui qui conduit ; le matin à deux heures on charge les légumes, les siens devant, les miens derrière. Je monte à côté de lui ; nous allons aux halles. Et les affaires terminées, ensemble on revient pour le travail du jour.
J’achevais, guidé par le maraîcher, de me promener sur les sentiers étroits ménagés entre les plates-bandes. Mon amie Nina nous suivait et cueillait, parmi les grands roseaux qui formaient haie autour de l’exploitation, un bouquet de liserons et de marguerites. Le jardin formait un long rectangle dont un grand côté dominait le ruisselet de la vallée, l’autre longeait le chemin vicinal établi à flanc de coteau ; sur l’un des petits côtés s’élevaient la maison mahonnaise, à simple rez-de-chaussée, de notre hôte, les hangars et quelques paillotes ; l’autre petit côté du quadrilatère était mitoyen d’un enclos que j’avais récemment acheté. Les opérations de courtage que je traitais avec un succès croissant, grâce à mes relations anciennes avec les commerçants du golfe de Guinée m’avaient rapporté de tels bénéfices, depuis plusieurs mois, qu’il me parut désirable de me mettre, comme on dit, dans mes meubles, d’acquérir une villa aux environs d’Alger, et de cultiver des roses et des œillets à mes moments perdus.
A vrai dire, ce fut Nina qui me harcela pour avoir la joie d’habiter une maison qui fût sa propriété. Mon Dieu, je confesse que la bonne fille avait, selon l’expression commune, gentiment rôti le balai à la Côte d’Ivoire, en compagnie des coupeurs de bois ; si elle était maîtresse dans l’art de shoker un cocktail, elle n’estimait point l’intellectualité, alors que j’avais des lettres, voire des diplômes d’université. Nous n’appartenions pas au même plan social. Mais nous avions bu ensemble le poison des tropiques et nulle force même de convenance n’aurait pu séparer l’un de l’autre deux bohèmes de la forêt dense.
Mon ami de jadis, Orner Joyce, qui avait couru avec moi la belle aventure et qui était à ce jour l’un des principaux patrons de la police d’Etat en Algérie, m’informa qu’un pavillon avec jardin était à vendre non loin de celui qu’il occupait au Frais-Vallon où il avait naguère émigré avec sa jeune épouse. Le site était des plus agréables ; le propriétaire menacé de poursuites par des créanciers coriaces, fut raisonnable dans ses prétentions ; bref l’affaire se conclut fort vite ; nous emménageâmes, et j’acquis, pour établir la liaison avec Alger une automobile à deux places que Nina apprit à conduire.
Le matin de notre installation, notre voisin Salvator Nin, galamment, nous avait offert son concours, et, comme Nina n’avait pas eu le loisir de faire son marché, il l’avait gratifiée d’un panier de ses produits choisis. Nous nous étions rendus chez lui aujourd’hui pour le remercier de sa politesse et le régaler d’un gros gâteau. Madame Nin nous accueillit avec la-plus grande bonté ; derrière son mari nous processionnâmes dans le jardin, où poussaient avec ordre et propreté d’admirables légumes.
Vous verrez que vous serez très bien ici, nous disait-il ; c’est un coin vert du paradis ; la terre est un gras terreau. Avec de l’huile de bras, de l’eau et du soleil, tout pousse dans cette vallée comme au pays de Canaan. Et il fit un grand signe de croix.
— Par malheur, Monsieur Nin, dit mon amie, il y a une ombre au tableau ; votre closerie est isolée dans la banlieue d’Alger et je ne vous apprendrai pas que le patelin est plein d’armées roulantes qui exploitent les environs de la ville. Supposez que vous soyez attaqué par surprise chez vous, la nuit, dans votre ferme, par une bande de sacripants, comment les repousserez-vous ? Sans doute, accourrions-nous, mon époux et moi, au cas où nous entendrions du bruit. Mais s’il y a pas de bruit?
— Ho, Madame, vous êtes logée à la même enseigne que moi !
— Non, parce que nous sommes reliés par téléphone à la maison d’Orner Joyce, où sont des plantons de permanence et au poste de police du quartier. Puis nos fenêtres ont des grilles, nos portes sont solides et nous possédons de bonnes armes dont nous savons nous servir. Nous avons même adopté un dispositif ingénieux de phares pour éclairer, en cas d’agression, les approches de la villa. Or vous n’avez ni téléphone, ni grilles.
— Mais j’ai Patrick ! Oh ! Vous ne connaissez pas Patrick ! Je vais vous présenter à lui.
Par une sente pratiquée au milieu de carrés où des femmes indigènes jacassantes ramassaient des pois, nous retournâmes à la maison mahonnaise ; Salvator nous introduisit dans l’arrière-cour du logis ; là étaient groupés des resserres, un hangar où bêlaient trois chèvres, l’écurie du mulet et une souille à porc ; un molosse à poil fauve dormait, enchaîné à sa niche, entre un colombier et la fosse à fumier. A notre approche l’animal s’éveilla, se mit debout, flaira l’air, eut une sorte de râle, et nous regarda sans aménité.
— C’est un bon copain, notre Patrick (et le chien en entendant son nom, agita la queue). Il n’accepte de nourriture que de ma femme et de moi, ne connaît que nous et est muet. Oui, il n’aboie pas. A la tombée de la nuit, nous le lâchons et il se ballade de l’angélus du soir à l’angélus du matin entre les choux et les navets, bien tranquille, sans galoper après les passants sur la route, sans fréquenter les chiens des voisins. Il fait le tour du propriétaire, quoi, mais gare à qui pénètre dans la propriété, s’il n’est pas dans ma société ou dans celle de ma femme. Il lui saute à la gorge sans prévenir, et cherche la carotide. C’est une bête qui est dressée à se méfier. Voilà !
Au crépuscule nous regagnons la villa par le chemin, désert à cette heure, qu’assombrissent des oliviers et les arbustes du maquis qui couvre au-dessus de nous les pentes du vallon ; notre jardin est encore à l’état de friche ; son entrée est étrécie par des ronciers qu’il a fallu dès le premier jour élaguer quelque peu pour permettre à notre petite auto d’accéder au pavillon. Le linge d’une abondante lessive est étendu sur des cordes auprès de la buanderie où chantonne du nez une laveuse indigène, alliée de la famille Mohand, le jeune auxiliaire kabyle à qui Orner Joyce reconnaît les qualités du policier avisé. Nina va distribuer des ordres à son, ouvrière et à sa bonne et je pénètre dans le vestibule où se tient Mohand soucieux et grognon.
— Bonsoir, mon petit, lui dis-je. Y a-t-il longtemps que tu es ici en sentinelle ?
— Je suis arrivé, monsieur, deux minutes après votre départ, et ne suis point ressorti.
— Tu avais sans doute des raisons d’agir ainsi. Ton patron t’a-t ‘il chargé d’une commission pour moi ?
— Oui ; il est retenu à son bureau d’Alger par une enquête. Mais il y a autre chose qui nous est personnel, à vous et à moi. Je m’explique. Monsieur, il y a un sale type qui est couché au milieu des arbousiers, de l’autre côté de la route, devant l’entrée de la villa. Depuis plus d’une heure il est embusqué là ! Il attend le moment propice pour barboter votre lessive. Il est dangereux ; Salem est un brigand ; un type de mon village ; il a six ou sept condamnations pour vol et coups et blessures. Prenez garde à ses manigances.
— Très bien, Mohand, j’ouvrirai l’œil. Laissons ce qui me concerne. Qu’y at-il entre toi et lui ?
— Il y a cette affaire, entre ma famille et la sienne, qu’on appelle la rekba ; nous lui devons un sang, une vengeance, quoi ! Peut-être sait-il que je suis ici. Il surveille, pour me zigouiller quand l’occasion se présentera, mes allées et venues.
— Salem est donc à la fois un voleur et un assassin. Je Comprends ton émotion.
— Je ne suis pas ému. Il croit être bien caché; et ignore que je l’ai dépisté. L’avantage est donc pour moi. En définitive vous avez à craindre pour votre linge et moi pour ma peau.
— Eh bien, mon petit, nous allons tâcher d’arranger ça. Préviens ta parente que pour éviter une mauvaise rencontre elle dînera et couchera ici.
— Que se passe-t-il ? demande Nina qui survient à ce moment. Oh ! Mes enfants, qu’il est bon de se sentir enfin chez soi, entre des murs dont on est le propriétaire ! Ça, ma laveuse est terrorisée ! Il paraît qu’un malandrin rôde autour de la baraque !
— Oui, et, si tu veux bien m’écouter, nous le réduirons à une pénible extrémité, et Mohand nous y aidera.
Notre conférence ne dura guère. En bonne fille de la brousse Nina n’était guère portée à s’effrayer d’un risque et Mohand ne manquait ni d’habileté ni de bravoure. Il fut convenu qu’à la franche tombée de la nuit la lessive qui séchait au jardin serait remplacée par trois ou quatre vieux draps et les loques à nettoyer les dallages. J’exécutai un petit travail dans la salle basse qui me servait d’atelier où j’avais un banc de menuisier et les outils de divers métiers. Nous dinâmes à notre heure, sous la tonnelle, à la lumière d’une lampe à incandescence ; pendant que la bonne achevait de laver sa vaisselle, je fumais ma pipe et mon amie raccommodait des hardes. Nous devions en effet donner au guetteur l’impression d’être dans une parfaite quiétude. En temps et lieu les feux furent éteints, les portes fermées ; la lune ne se lèverait qu’à dix heures ; l’incursion de l’ennemi sur notre territoire serait retardée aux premières clartés de Phoebe au berceau.
— Tu peux déguerpir, dis-je à Mohand, par la porte de derrière avec ton matériel. Sois prudent. Et à propos, lui demandai-je en arabe, ton Salem croit-il aux prestiges des démons de la nuit ?
— Et quel est, me répondit-il dans la même langue, le paysan parmi les paysans qui n’y croit pas ? Moi-même, par ta tête, j’en ai vus dans le lit des oueds où ils dansaient avec les rayons de la lune.
Quand il s’exprimait en français, Mohand était voltairien, et n’avait foi ni à Dieu ni à diable. Parlait-il arabe, il redevenait crédule.
Il nous quitta. Il n’y eut plus, dans la vallée, d’autre bruit que des abois lointains de chiens dons les fermes, les coassements des grenouilles, les chants des grillons. Couchés à plat ventre sur la terrasse Nina et moi montions la garde et observions la campagne par une mince meurtrière. Bientôt le ciel devint opalescent, et l’on distingua confusément les arbres et les masses. Je frôlai du coude le coude de mon amie.
— Voici le camarade ! Murmurai-je.
Il s’avançait, pieds nus, lentement, l’oreille au guet, pliant le corps, fléchissant sur les genoux ; arrivé près de la cuisine il détacha avec prestesse les pièces de linge et les empaqueta sur son bras. A ce moment, je me redressai et modulai le rauque cri de guerre des Bobos de la Boucle, cri à la fois féroce et lamentable. Cette clameur sauvage surprit si bien le larron qu’il tourna les talons, bondit, et à toutes jambes s’enfuit vers la sortie, mal discernable entre les deux ronciers. Soudain II heurta un obstacle invisible qui le culbuta sur le sol. A peine s’était-il relevé qu’un fantôme phosphorescent se dressait sur son chemin et secouait une tête hideuse à la chevelure hérissée.
Sans attendre son reste le voleur s’échappa et courut comme s’il avait l’enfer aux trousses, vers la haie de roseaux qui séparait mon bien de celui de Salvator Nin. A deux mains il écarta la haie et je l’aperçus qui sautait dans le jardin voisin. Et à, cet instant un hurlement de douleur et d’effroi jaillit dans la nuit.
— Bigre, murmurai-je à l’oreille de Nina, je ne voudrais pas être à sa place. Le chien Patrick !
— Quel chien ?
— Le molosse muet qui veille sur les légumes de Salvator vient de s’immiscer dans l’affaire ; te rappelles-tu que d’après son maître il a l’humeur féroce ?
Mohand frappe à la porte ; je descends lui ouvrir.
Dans le vestibule j’allumai une lanterne, tirai les verrous. Le garçon était impassible. Il me rendit le rouleau de fil de fer, le manche à balai, la touffe de filasse et le cerceau de barrique tendu de papier rouge barbouillé de cette pâte phosphorée que les droguistes vendent comme mort aux rats. Je lui avais confié ces objets une heure auparavant.
Puis il se laissa choir sur la natte et sans un mot, la tête entre les bras, se mit à rire, mais à rire…
Robert RANDAU
Grand Prix Littéraire de l’Algérie 1930
![alger frais vallon 1937]()
![frais vallon]()
frais vallon